| Accueil » » Sogyal Rinpoché, pas si Zen ce Rinpoché |
Sogyal Rinpoché, pas si Zen ce Rinpoché |
Sogyal Rinpoché en personne, tu te rends compte ? » « Je l'ai déjà vu une fois pendant une conférence à Amsterdam, mais de loin » « Une semaine entière avec lui... Je me sens tellement privilégiée.» Dans le luxueux temple bouddhiste de Lerab Ling, niché au coeur des Cévennes à Roqueredonde, l'excitation atteint son comble : l'arrivée du maître a été annoncée. Assis dans la position du lotus - éminemment inconfortable pour quiconque ne pratique pas assidûment le yoga -, les disciples ont écouté patiemment le discours d'introduction à cette retraite de méditation qui va les occuper pendant huit jours. Ils ont bien noté les règles à respecter : ne pas boire d'alcool, ne pas fumer, ne pas utiliser son téléphone portable, et parler le moins possible. Sauf sur le parking du centre, où ces comportements de débauche sont autorisés. Maintenant, action ! Les retraitants veulent voir leur gourou, en chair et en os. Sogyal Rinpoché ? Un lama de renommée mondiale. Né au Tibet en 1947, il a été reconnu très jeune comme la réincarnation d'un des maîtres du treizième dalaï-lama, ce qui impose le respect de la communauté religieuse. Dès son arrivée en Europe, en 1971, il commence à enseigner les rudiments du bouddhisme tibétain aux Occidentaux. En plein rejet du christianisme, la génération hippie se passionne pour cette forme de spiritualité exotique. Esprit moderne, corps tibétain Obèse mais énergique, le petit homme prend de l'envergure, jusqu'à fonder le centre de Lerab Ling. Le temple, modèle d'architecture bling-bling en pleine nature, est inauguré en grande pompe par le dalaï-lama en 2008, en présence de Carla Bruni-Sarkozy, Rama Yade et Bernard Kouchner. Il accueille aujourd'hui de 2 000 à 3 000 retraitants chaque année. La brochure de promotion dit de Sogyal Rinpoché qu'il a un « don remarquable pour réunir plus de deux mille cinq cents ans de sagesse et d'expérience bouddhistes d'une manière authentique, accessible, et tout à fait pertinente pour le monde d'aujourd'hui ». Un esprit moderne dans un corps tibétain (ou l'inverse) : le gourou fait mouche chez les Européens en quête de sens. Il est aussi l'autorité spirituelle de l'association Rigpa qui rassemble 130 centres bouddhistes dans 41 pays du monde, et l'auteur du Livre tibétain de la vie et de la mort, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde. Autant dire que Sogyal Rinpoché est à l'amateur de nourriture spirituelle ce que Lady Gaga est au fan de musique pop : une superstar. Mais sa notoriété et le succès que rencontrent les retraites n'empêchent pas les rumeurs persistantes sur la légitimité du personnage. Rinpoché ne serait pas le véritable auteur de l'ouvrage qui a fait sa renommée, et surtout, il entretiendrait des relations à la limite de l'abus de pouvoir avec ses disciples les plus proches (lire plus bas)... Mais, en ce mois de juillet 2011, les 500 personnes inscrites à la traditionnelle retraite estivale de Lerab Ling ont d'autres préoccupations. Venues d'Italie, des Pays-Bas, d'Allemagne, d'Angleterre ou de France, toutes ont délaissé les plages et l'apéro au rosé pour s'isoler huit jours dans l'espoir de découvrir les secrets de la méditation. On compte bien dans l'assemblée un hippie quinqua et deux ados gothiques, mais l'essentiel est constitué de gens « ordinaires », venus seuls, en couple ou en famille. Unis par l'originalité de leur démarche, les participants ont le bon goût de ne pas se taper dessus quand les précieux coussins, indispensables pour tenir des heures assis en tailleur, viennent à manquer. Ceux qui en avaient discrètement empilé cinq sous leur postérieur ne rechignent pas longtemps à les céder à leur voisin : l'essentiel, après tout, est d'être en position de voir le gourou. Les architectes du temple ont prévu le coup en disséminant des écrans plats un peu partout dans la salle. Des interprètes se chargent de traduire les discours de l'anglais syncopé de Sogyal Rinpoché (« Is dat clear ? D'you undeustand ? ») dans les différentes langues des retraitants. Humiliations publiques Quand le maître apparaît enfin sur l'estrade dans sa robe orange, comme il le fera chaque jour aux alentours de midi, les 500 groupies se lèvent comme un seul homme. Les plus zélés entament même une prosternation bouddhiste (genoux, ventre et front à terre) difficile à mener à bien, chacun disposant d'un espace limité aux dimensions de son coussin. Sogyal Rinpoché, c'est 1 m3 de pure sagesse : ça s'accueille dignement. « Il a les cheveux plus noirs que la dernière fois, non ? » murmure une femme à son mari. Rinpoché, qui signifie en tibétain « le Très Précieux », prend effectivement soin de son apparence. Les cheveux blancs, c'est un charme dont il se passe. Ce matin-là, dans le temple à la décoration surchargée, où domine un bouddha en or de 7 m de haut, le gourou pointe d'un doigt agacé un grand portrait de maître placé derrière lui. « Qu'est-ce qu'elle fait là, cette photo ? » demande-t-il sèchement à ses assistants. S'ensuivent vingt minutes de mise au point et de brimades, alors que nonnes et disciples s'agitent en tous sens pour déplacer la photo. Au fil des « enseignements » dispensés chaque jour, ces scènes deviendront vite habituelles : loin du calme détachement du dalaï-lama, le chef spirituel du temple de Lerab Ling s'énerve, se moque et engueule ses collaborateurs. Qui pour une photo, qui pour un verre tombé, qui pour une porte mal fermée. L'exercice prend parfois des allures d'humiliation publique. « Faites-moi penser à investir dans un costume et une coupe de cheveux pour lui », dira-t-il à propos d'un de ses disciples, déclenchant l'hilarité de la salle. De quoi rendre perplexes certains élèves. Laura, une Française de 31 ans, s'interroge : « Je n'arrive pas à faire le lien entre le Livre tibétain de la vie et de la mort, qui m'a bouleversée, et le personnage que je viens de découvrir ». Les « nouveaux » se rejoignent tous sur un point : pourquoi diable le maître s'acharne-t-il sur ses assistants qui se plient en quatre pour le servir ? « C'est vrai que cela peut surprendre, reconnaît Jack*, l'un des animateurs, un Américain qui essuie au moins 10 blagues par jour de la part du gourou. Mais c'est un enseignement. Si vous ne comprenez pas, c'est le but ! C'est pour casser vos concepts et vos habitudes ». Soit. Les retraitants ne se découragent pas pour si peu, et ils continuent à se lever de bonne grâce pour être à 9 heures pétantes dans le temple, prêts à recevoir la bonne parole. L'épreuve du feu pour tester la volonté des disciples de casser tous leurs concepts se présente le troisième jour. Sans doute encouragé par le climat de compassion qui règne à Lerab Ling, un Néerlandais d'une quarantaine d'années juge le moment opportun pour se confesser devant le maître, et accessoirement devant les centaines de personnes également présentes dans le temple. L'homme prend la parole pour évoquer ses problèmes conjugaux, et la manière dont sa femme lui hurle dessus à toute occasion. Le gourou se lance alors dans un véritable show : « Avez-vous essayé de l'interrompre en l'embrassant ? Ou en lui faisant l'amour passionnément ? Non ? Et sinon, avez-vous essayé de prendre des cours de karaté ? » Le succès est immédiat, les retraitants se tapent sur les cuisses. « Vous êtes néerlandais ? Ce sont les pires. Peut-être que votre femme a raison de dire que vous ne savez pas communiquer ! Avez-vous essayé de lui dire simplement : « Jawohl, jawohl, mein Führer » ?» La salle s'étrangle de rire devant ces conseils illuminés de sagesse. Mais la séance prend un tour inattendu quand l'homme se met à raconter ce qui suscite le courroux de sa femme : « J'ai travaillé pendant vingt-cinq ans avec des enfants handicapés mentaux. Un jour, j'ai abusé de ma position avec l'un d'eux ». Frémissement dans l'auditoire. « Je l'ai dit à ma femme, et c'est pour ça qu'elle fait peser une pression terrible sur moi, elle a toujours peur que je fasse quelque chose à notre fille de 4 ans ». Devant le manque d'ouverture d'esprit manifeste de l'épouse, le maître choisit le silence. Il commence à être à court de blagues. « Un jour, elle a dû partir quelques jours. J'ai fait couler un bain pour ma fille et moi... L'eau était trop chaude, j'ai eu une sorte de malaise : je pouvais entendre et voir, mais je ne pouvais pas bouger. Et c'est là que ma fille m'a sucé ». La salle est muette, interdite. Sogyal Rinpoché reprend la parole : « C'est très courageux de le dire devant tout le monde ». Des applaudissements compatissants viennent saluer l'aveu de ces deux crimes pédophiles. Le soir, on annonce que le « monsieur ayant tenu des propos provocants » a quitté la retraite et que « des gens compétents s'en occupent ». Le sujet divise les retraitants et alimente toutes les conversations. Les plus anciens élèves viennent voir les nouveaux, pour discuter avec eux du « mouvement de colère » que l'épisode soulève chez certains. « C'est intéressant que tu réagisses de manière aussi virulente, estime une disciple confirmée d'une soixantaine d'années, en s'adressant à une jeune femme en larmes. - Pour moi, c'est stupéfiant que ça te laisse aussi indifférente », lui répond-elle. Dès le lendemain cependant, l'épisode du « Néerlandais aux propos provocants » est enterré. Silence, le gourou pète ! Encore cinq jours à tenir. Chacun se recentre sur son objectif : apprivoiser l'esprit qui s'échine à nous rendre malheureux, réveiller le bouddha qui sommeille en nous. Pour l'atteindre, une seule solution : suivre le maître. Les retraitants apprennent bien vite que tout ce que fait ou dit Rinpoché est un teaching, un « enseignement ». Personne n'a de mal à le comprendre quand il évoque avec beaucoup de clarté les principes de base de la méditation. Les élèves, enchantés, commencent à toucher du doigt le calme que procure la pratique du « repos de l'esprit », et c'est bien pour cela qu'ils sont venus. Mais c'est beaucoup moins évident quand le gourou se transforme en incarnation tibétaine de Jean-Marie Bigard et se met à imiter le bruit d'un pet ou à disserter sur les vibromasseurs. Ou quand il passe la moitié de la session à rabrouer son équipe parce que son gratte-dos n'est pas en place. Pendant le déjeuner, les retraitants échangent leurs impressions. Le conseil dispensé par les disciples confirmés est limpide : il ne faut surtout pas entrer en « résistance » avec les enseignements. Seule la « dévotion » de l'élève permet d'atteindre une authentique « connexion » avec Rinpoché. C'est lui-même qui l'explique le plus clairement : « Suivez les enseignements, ne réfléchissez pas trop. Je suis votre boss, je suis votre maître, votre rôle est de me suivre ». Au début de la semaine, l'accent était mis sur la communication ; mais à partir du quatrième jour, le gourou change d'avis et propose de supprimer les ateliers de discussion de l'après-midi qui, selon lui, ne servent à rien. On conseille au néophyte en quête d'éveil de ne pas trop poser de questions, mais plutôt de regarder le visage du maître quand il médite, d'écouter sa voix qui a des « pouvoirs spéciaux » et de prier pour lui quand il n'est pas dans son assiette. Sogyal Rinpoché promet que la technique a fait ses preuves. Il raconte comment certains de ses élèves ont guéri du cancer ou retrouvé la vue grâce à la force de leur « connexion ». Motivés, la plupart des retraitants suivent ces conseils avisés. Après tout, ils ont bien l'intention de tirer un maximum de bénéfices de l'expérience : ils ont payé pour ça. Cash machine Les plus jeunes et les plus fauchés (souvent les mêmes) ont déboursé 500€. Pour cette somme, ils ont accès aux enseignements, aux repas (légumes avec accompagnement de... légumes), et sont autorisés à planter leur tente dans la forêt. Il y a beaucoup de moustiques, et la distance qui sépare les dernières tentes du bloc sanitaire transforme toute envie nocturne en véritable expédition. Par ailleurs, les tempêtes à répétition et les températures autour de 7 °C (le centre est perché à 850 m d'altitude) ont fini par faire craquer les plus vaillants. Au sixième jour, une Française se jetait en travers du chemin de Sogyal Rinpoché pour implorer de dormir dans un endroit sec. Son geste désespéré et ses cernes sous les yeux ont convaincu le maître, qui lui a affecté un chalet privé pour la nuit suivante. Au grand dam de tous les autres campeurs qui ont amèrement regretté de ne pas avoir eu la même idée... ou de ne pas avoir rallongé la facture de quelques centaines d'euros pour dormir dans un chalet. Les retraitants doivent également s'acquitter d'une tâche quotidienne appelée « rota » pour participer à la vie du temple. Les plus «avancés » sur le chemin spirituel n'hésitent pas à se dévouer au nettoyage des toilettes, les autres préfèrent donner un coup de main à la compta : 500€ minimum la retraite multipliée par 2 000 ou 3 000 disciples, cela fait au bas mot de 1 à 1,5 million d'euros qui rentrent dans les caisses. Ils peuvent aussi aider la boutique du centre. C'est dans cette échoppe que l'on peut faire l'acquisition des ouvrages spirituels de référence et des photos des grands maîtres. L'endroit offre également l'occasion d'apprécier qu'on peut être bouddhiste sans être dépourvu d'un sens aigu du marketing : tasses Lerab Ling, coussins de méditation Lerab Ling et T-shirts « Osez la méditation ! », on trouve de tout. A la fin de la retraite, les participants dépensent facilement 70€ pour rapporter chez eux un souvenir de cette semaine hors du temps pendant laquelle ils se sont consacrés, souvent avec quelque succès, à l'apaisement de leur esprit, en méditant plusieurs heures par jour et en écoutant en boucle le message du Bouddha. Ou plutôt celui de Sogyal Rinpoché, qui pourrait se résumer en deux mots : « Adulez-moi ». Mais, pour l'instant, ceux qui s'en plaignent à voix haute sont encore rares... * Tous les prénoms ont été changés. Profession : esclave de gourou En novembre 1994, une femme connue sous le pseudonyme de Janice Doe porte plainte contre Sogyal Rinpoché pour « abus sexuel, mental et physique ». L'affaire se règle hors tribunal par une transaction financière. Si aucune nouvelle plainte en justice n'a été déposée depuis, les forums Internet regorgent de témoignages d'élèves ayant quitté l'association de Sogyal Rinpoché en raison d'un comportement jugé « non conventionnel ». Daniel Genty est le créateur d'un blog consacré au cheminement spirituel intitulé « Les voies de l'âme ». En octobre 2007, il poste un extrait du Livre tibétain de la vie et de la mort qui lui a particulièrement plu. A sa grande surprise, le billet suscite pas moins de 462 réactions, dont certaines sont particulièrement virulentes à l'adresse du chef spirituel de Lerab Ling. Car voilà : Rinpoché se revendique d'une tradition, celle de la « folle sagesse » (lire l'entretien avec Marion Dapsance plus bas). Un héritage particulièrement inadapté aux normes occidentales, dans la mesure où il autorise toutes les pratiques, notamment sexuelles, pouvant amener les élèves à l'éveil. « Le maître, c'est comme le feu, dit un proche du gourou. Si on en est loin, on a froid ; si on s'approche trop, on se brûle ». Mimi, qui a travaillé comme assistante personnelle du maître pendant trois ans, fait partie de celles qui se sont brûlées. « Mon job, c'était d'être à sa disposition : le laver, l'habiller, transmettre ses ordres aux autres, dormir au pied de son lit au cas où il aurait besoin de moi, préparer ses voyages...» S'occuper du maître n'est pas une mince affaire. Chaque déplacement de Rinpoché mobilise des dizaines de personnes et répond à des règles dignes du protocole royal britannique. Le « collaborateur » privilégié se voit remettre un document de plusieurs dizaines de pages de consignes à respecter : veiller à ce qu'il y ait toujours de la nourriture et à boire dans la voiture, s'assurer que quelqu'un à l'arrivée est prêt à lui ouvrir la portière, exiger un menu composé de viande bovine quand Rinpoché doit prendre l'avion (loin d'être végétarien, le maître adore le boeuf), ainsi qu'une place à l'avant de la cabine... La liste est sans fin. « Après quatre mois de ce régime, on est épuisé, on ne réfléchit plus. Le jour où il m'a demandé de me déshabiller, je l'ai pris comme un test de plus pour évaluer ma dévotion », dit Mimi. Un « test » qui lui a été présenté comme une grande chance dont elle devait à tout prix conserver le secret. Aujourd'hui, alors qu'elle a définitivement quitté le maître, l'ancienne disciple a décidé de parler. Elle a témoigné dans le cadre d'un documentaire sur les abus de pouvoirs intitulé « In The Name Of Enlightenment » (« Au nom de l'éveil »). Réalisé par Debi Goodwin, le film a été diffusé le 23 mai 2011 sur la chaîne canadienne Vision TV. Mimi travaille à l'écriture d'un conte autobiographique sur ses rencontres dans le bouddhisme. Dans l'entourage du maître, on rappelle que Rinpoché n'est pas un moine, et qu'il est en droit d'avoir des relations sexuelles avec ses élèves si elles sont consentantes : « Tout ce que fait le maître, c'est toujours dans le but d'amener à l'éveil. Si la disciple ne comprend pas la chance qu'elle a d'avoir une telle connexion avec le maître, c'est que son ego revient en force. C'est très dommage ». source:http://www.marianne.net/Le-lama-Rinpoche-a-Paris-pas-si-zen-ces-bouddhistes_a211593.html |
| Accueil » » Sogyal Rinpoché, pas si Zen ce Rinpoché |
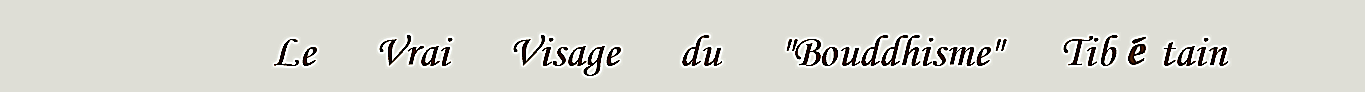
简体|正體|EN|GE|FR|SP|BG|RUS|JP|VN Le Vrai Visage du "Bouddhisme" Tibétain Accueil | Connecter | Déconnecter
- la théorie du lapin sans cornes
- La pratique du tantra Yoga
- La pratique du nectar « bdud-rtsi»
- Le Dalai Lama agent de la CIA
- Temple des Mille Bouddhas : des lamas accusés de v
- Le bouddhisme tibétain et le Dalai Lama
- Le Dalai lama et son disciple Shoko Asahara
- Tantra Kalachacra
- « Les confessions de Kalou rinpoché » sur la toile
- Un lama suspect en détention provisoire à Varennes
- Sogyal Rinpoché, pas si Zen ce Rinpoché
- Dalaï-Lama : pas si zen
- Dalaï-Lama n'est qu'un imposteur
- Des temples ... pas si accueillants
- Dalai Lama et la CIA, l'histoire d'une vieille a
- Le Dalaï Lama。 le Prix Nobel du mensonge
- Bande dessinée
- Le livre de poche
Before Buddhism was brought to Tibet, the Tibetans had their believes in "Bon". "Bon" is a kind of folk beliefs which gives offerings to ghosts and gods and receives their blessing. It belongs to local folk beliefs.
In the Chinese Tang Dynasty, the Tibetan King Songtsän Gampo brought “Buddhism” to the Tibetan people which became the state religion. The so-called “Buddhism” is Tantric Buddhism which spreads out during the final period of Indian Buddhism. The Tantric Buddhism is also named "left hand tantra" because of its tantric sexual practices. In order to suit Tibetan manners and customs, the tantric Buddhism was mixed with "Bon". Due to its beliefs of ghosts and sexual practices, it became more excessive.
The tantric Master Atiśa spread out the tantric sex teachings in private. Padmasambhava taught it in public, so that the Tibetan Buddhism stands not only apart from Buddhist teachings, but also from Buddhist form. Thus, the Tibetan Buddhism does not belong to Buddhism, and has to be renamed "Lamaism".












