| Accueil » » Le Dalai Lama agent de la CIA |
Le Dalai Lama agent de la CIA |
Patrick French, alors qu'il était directeur de la « Free Tibet Campaign » (Campagne pour l'indépendance du Tibet) en Angleterre, a été le premier à pouvoir consulter les archives du gouvernement du Dalaï-Lama en exil. Il en a tiré des conclusions étonnantes. Il en est arrivé à la conclusion dégrisante que les preuves du génocide tibétain par les Chinois avaient été falsifiées et il a aussitôt donné sa démission en tant que directeur de la campagne pour l'indépendance du Tibet (1). Dans les années soixante, sous la direction du frère du Dalaï-Lama, Gyalo Thondrup, des témoignages furent collectés parmi les réfugiés tibétains en Inde. French constata que les chiffres des morts avaient été ajoutés en marge par après. Autre exemple, le même affrontement armé, narrée par cinq réfugiés différents, avait été comptabilisée cinq fois. Entre-temps, le chiffre de 1,2 million de tués par la faute des Chinois allait faire le tour du monde. French affirme que ce n'est tout bonnement pas possible : tous les chiffres concernent des hommes. Et il n'y avait que 1,5 million de Tibétains mâles, à l'époque. Il n'y en aurait donc quasiment plus aujourd'hui. Depuis, la population a augmenté pour atteindre presque 6 millions d'habitants actuellement, soit presque deux fois plus qu'en 1954. Chiffre donné et par le Dalaï-Lama et les autorités chinoises, étonnamment d'accord pour une fois. Les observateurs internationaux (la Banque mondiale, l'Organisation mondiale de la santé) se rangent d'ailleurs derrière ces chiffres. N'empêche qu'aujourd'hui encore, le Dalaï-Lama continue à prétendre que 1,2 million de Tibétains sont morts de la faute des Chinois. Le dalaï-lama est-il une sorte de pape du bouddhisme mondial ? Ici, il convient de relativiser les choses. 6 % de la population mondiale est bouddhiste. C'est peu. En outre, le dalaï-lama n'est en aucun cas le représentant du bouddhisme zen (Japon), ni du bouddhisme de l'Asie du Sud-Est (Thaïlande), ni non plus du bouddhisme chinois. Le bouddhisme tibétain représente seulement 1/60e de ces 6 %. Et, enfin, il existe de plus au Tibet quatre écoles séparées. Le Dalaï-Lama appartient à l'une d'elles : la « gelugpa » (les bonnets jaunes). Bref, un pape suivi par peu de fidèles religieux, mais par beaucoup d'adeptes politiques… Qui sont ses sponsors ? De 1959 à 1972 : - 180.000 dollars par an pour lui personnellement, sur les fiches de paie de la CIA (documents libérés par le gouvernement américain ; le dalaï-lama a nié la chose jusqu'en 1980). - 1,7 million de dollars par an pour la mise en place de son réseau international. Ensuite le même montant a été versé via une dotation du NED, une organisation non gouvernementale américaine dont le budget est alimenté par le Congrès. Le Dalaï-Lama dit que ses deux frères gèrent « les affaires ». Ses deux frères, Thubten Norbu (un lama de rang supérieur) et Gyalo Thondrup avaient été embauchés par la CIA dès 1951, le premier pour collecter des fonds et diriger la propagande et le second pour organiser la résistance armée. La bombe atomique indienne : le bouddha souriant Dès le début, c'est-à-dire quand il est devenu manifeste que la révolution chinoise allait se solder par un succès en 1949, les USA ont essayé de convaincre le dalaï-lama de gagner l'exil. Ils mirent de l'argent, toute une logistique et leur propagande à sa disposition. Mais le dalaï-lama et son gouvernement voulaient que les États-Unis envoient une armée sur place comme ils l'avaient fait en Corée et ils trouvèrent donc la proposition américaine trop faible. (Modern War Studies, Kansas University, USA, 2002). En 1959, les Etats-Unis parvenaient quand même à convaincre le dalaï-lama de quitter le Tibet, mais il fallait encore convaincre l'Inde de lui accorder l'asile. Eisenhower proposait un « marché » à Nehru : l'Inde acceptait le dalaï-lama sur son territoire et les Etats-Unis octroyaient à 400 ingénieurs indiens une bourse d'études afin qu'ils s'initient à la « technologie nucléaire » aux États-Unis. Le marché fut accepté2. En 1974, la première bombe A indienne fut affublée du surnom cynique de… « bouddha souriant ». Source : http://www.alterinfo.net/La-CIA-sponsor-du-Dalai-Lama_a17923.html Tibet, le « Grand Jeu », et la CIA Etant donné le contexte historique de l'agitation au Tibet, il existe une raison de croire que Beijing a été pris par surprise lors des manifestations récentes pour la simple raison que leur planification a eu lieu en dehors du Tibet et que la direction des manifestants est aussi entre les mains d'organisateurs anti-chinois, qui se trouvent en sécurité et hors de portée, au Népal et en Inde du Nord. De même, le financement et le contrôle général de l'agitation sont liés au dirigeant spirituel tibétain, le Dalaï Lama, et par voie de conséquence à la CIA, à cause de la coopération rapprochée du Dalaï Lama avec le renseignement US depuis plus de 50 ans. Effectivement, compte tenu de l'implication profonde de la CIA avec le Mouvement Free Tibet (Mouvement Liberer le Tibet) et son financement de Radio Free Asia suspicieusement bien informée, il semble peu probable que toute révolte puisse avoir été planifiée ou puisse avoir eu lieu sans que le National Clandestine Service ( Service National Clandestin auparavant connu sous le nom de Directorate of Opérations - Directoire des Opérations), qui se trouve aux quartiers généraux de la CIA à Langley, n'en ait eu au préalable connaissance. L'ex haut responsable des services secrets indou et journaliste respecté, B Raman, a fait le 21 mars le commentaire suivant : « sur la base de preuves disponibles, c'est raisonnablement possible d'affirmer avec conviction que le soulèvement initial à Lhasa le 14 mars a été pré-planifié et bien orchestré. » Se pourrait-il qu'il y ait une base factuelle suggérant que les principaux bénéficiaires de la mort et de la destruction qui a balayé le Tibet sont à Washington ? L'Histoire suggère que c'est effectivement une possibilité. La CIA a mené une campagne d'actions clandestines de grande envergure contre la Chine communiste au Tibet et ce dés 1956. Cela a conduit à un désastreux soulèvement sanglant en 1959, faisant des dizaines de milliers de morts parmi les Tibétains, tandis que le Dalaï Lama et environ 100 000 de ses adeptes ont été obligés de fuir au Népal et en Inde en passant par les passages dangereux de l'Himalaya. La CIA a établi un camp militaire secret d'entraînement pour les combattants de la résistance du Dalaï Lama à Camp Hale près de Leadville au Colorado aux US. Les guérilléros tibétains ont été entraînés et équipés par la CIA pour mener des opérations de guérillas et de sabotage contre les Chinois communistes. Les guérilléros entraînés par les US ont mené régulièrement des raids à l'intérieur du Tibet, occasionnellement dirigés par des mercenaires sous contrat avec la CIA, et soutenus par des avions de la CIA. Le programme initial d'entraînement s'est terminé en décembre 1961, bien qu'il semble que le camp du Colorado soit resté ouvert au moins jusqu'en 1966. La Force d'Intervention Tibétaine de la CIA crée par Roger E. McCarthy, parallèlement à l'armée tibétaine de guérilléros a continué à mener des opérations sous le nom de code ST CIRCUS, pour harasser les forces d'occupation chinoises pendant 15 ans jusqu'en 1974, puis l'implication approuvée officiellement s'est arrêtée. McCarthy, qui a aussi dirigé la Force d'Intervention pour le Tibet lors du pic de ses activités de 1959 jusqu'en 1961, a continué plus tard à mener des opérations identiques au Vietnam et au Laos. A mi chemin des années 60, la CIA avait remplacé sa stratégie de parachutage de combattants de la guérilla et d'agents des services secrets à l'intérieur du Tibet, par celle de la mise sur pied de l'armée de guérilléros, Chusi Gangdrük, comprenant 2000 combattants d'origine ethnique Khamba, regroupés sur des bases comme celle de Mustang au Népal. Cette base n'a seulement été fermée par le gouvernement népalais qu'en 1974, après une formidable pression de Beijing. Après la guerre Indo-Chinoise de 1962, la CIA a développé une relation rapprochée avec les services de renseignements indous, à la fois pour entraîner et fournir des agents au Tibet. Kenneth Conboy et James Morrison dans leur livre The CIA's secret War in Tibet » révélent que la CIA et les services de renseignements indous ont coopéré dans l'entraînement et pour équiper des agents tibétains et des troupes de forces spéciales et pour former des unités aériennes spéciales de renseignements telles que l'Aviation Research Center (Centre de Recherche pour l'Aviation) et le Spécial Center (Centre Special). Cette collaboration a continué pendant une grande partie des années 70 et certains des programmes qu'ils ont soutenus, spécialement celui concernant l'Unité des Forces Spéciales des réfugiés tibétains, qui deviendra une partie importante de la Force Frontalière Spéciale Indoue, est toujours présentement actif. C'est la détérioration des relations avec l'Inde, qui a coïncidé avec celle de l'amélioration Inde - Beijing, qui a mis fin à la plupart des opérations conjointes CIA –Inde. Bien que Washington est rétrogradé en matière de soutien aux guérilléros tibétains depuis 1968, on pense que la fin du soutien officiel pour la résistance s'est produite lors de rencontres à Beijing en février 1972, entre le président Richard Nixon et la direction communiste chinoise. Victor Marchetti, un ancien officier de la CIA a décrit l'outrage ressenti par de nombreux agents de terrain quand Washington à effectuer finalement le déconnection, ajoutant qu'un certain nombre « se sont même mis, pour se consoler, aux prières tibétaines, qu'ils avaient apprises pendant ces années passées avec le Dalaï Lama ». L'ancien chef de la Force d'Intervention Tibétaine de la CIA de 1958 à 1965, John Kenneth Knaus, a été cité disant : « ce n'était pas une opération « trou noir » de la CIA ». Il a ajouté : « l'initiative venait de …tout le gouvernement US. » Dans son livre, « Orphans of the Cold War « (Orphelins de la Guerre Froide), Knaus décrit le sentiment américain d'obligation concernant la cause de l'indépendance du Tibet de la Chine. Il ajoute, significativement, que sa réalisation « justifierait les motifs les plus défendables que nous ayons eu d'essayer de les aider à réaliser ce but pendant plus de 40 ans. Cela soulagerait également certains de la culpabilité d'avoir participer à ces efforts, qui ont coûtés leurs vies à d'autres, mais qui était le fait d'une aventure menée principalement par nous. » Malgré le manque de soutien officiel, des rumeurs circulent largement sur l'implication de la CIA, ne serait que par le biais de proxy, lors d'une autre révolte ayant échoué en 1987, l'agitation qui a suivi, et, conséquence, la répression chinoise qui a continué jusqu'à mai 1993. Le moment choisi pour une autre tentative sérieuse de déstabiliser l'emprise chinoise sur le Tibet, est semble-t-il propice pour la CIA, et Langley (actuel directeur de la CIA ndlt) gardera certainement toutes les options ouvertes. La Chine est confrontée à des problèmes significatifs, avec les musulmans Uighur dans la province du Xinjiang, les activités des Falun Gong, parmi de nombreux groupes dissidents, et bien sûr le souci croissant d'assurer la sécurité des jeux olympiques de cet été en août. La Chine est vue par Washington comme une menace majeure, à la fois économiquement et militairement, non pas seulement en Asie, mais aussi en Afrique et en Amérique Latine. La CIA voit également la Chine comme « n'aidant pas » dans la « guerre contre le terrorisme », offrant peu ou pas de coopération et aucune action positive menée pour stopper le flux d'armes et d'hommes venant des zones musulmanes de l'Ouest de la Chine en soutien aux mouvements islamistes extrémistes en Afghanistan et dans les états d'Asie Centrale. Pour beaucoup à Washington cela semble l'opportunité idéale pour déstabiliser le gouvernement de Beijing car le Tibet est toujours considéré comme le point faible potentiel de la Chine. La CIA s'assurera sans nul doute que ses empreintes ne soient pas trouvées partout sur cette révolte ascendante. Des agents isolés, et des proxy seront utilisés parmi les réfugiés tibétains au Népal et dans les zones frontalières du Nord de l'Inde. En fait, la CIA peut s'attendre à un niveau significatif de soutien de la part d'un certain nombre d'organisations de sécurité à la fois en Inde et au Népal, et n'aura aucun problème à fournir au mouvement de la résistance, conseil, argent et par-dessus tout, publicité. Cependant, aucune arme ne sera autorisée à faire surface, tant que l'agitation ne s'accompagnera pas de signes révélateurs d'une révolte ouverte en devenir de la grande masse ethnique des Tibétains contre les Chinois Han et les Musulmans Hui. D'importantes quantités d'armes légères et d'explosifs venant de l'ancien bloc de l'Est ont été introduites clandestinement au Tibet ces 30 dernières années, mais il y a de fortes chances qu'elles restent cachées, en sécurité, jusqu'à ce que le bon moment se présente pour les sortir. Les armes ont été acquises sur les marchés mondiaux, ou de stocks sur lesquels les forces armées US et israéliennes ont mis la main. Elles ont été expurgées et ne présentent aucune trace pouvant les faire remonter jusqu'à la CIA. Des armes de ce type ont également l'avantage d'être interchangeables avec celles utilisées par les forces armées chinoises et bien sûr elles utilisent les mêmes munitions, diminuant le problème de réapprovisionnement lors de tout conflit futur. Bien que le soutien officiel pour la résistance tibétaine se soit terminé il y a 30 ans, la CIA a conservé ouvertes ses lignes de communication, et continuent de financer en grande partie le Tibetan Freedom Mouvement (Mouvement Liberté pour le Tibet). Ainsi donc, la CIA est-elle une nouvelle fois entrain de jouer le « Grand Jeu » au Tibet ? Elle en a certainement la capacité, avec une présence significative des renseignements et de forces paramilitaires dans la région. D'importantes bases existent en Afghanistan, en Irak, au Pakistan, et dans plusieurs états d'Asie Centrale. On ne peut pas douter du fait que la CIA a un intérêt à saper la Chine, de même que la cible plus visible qu'est l'Iran. Donc probablement que la réponse est oui, et effectivement, ce serait plutôt surprenant si la CIA ne manifestait qu'un intérêt passager pour le Tibet. C'est après tout ce pour quoi elle est payée. Depuis le 11 septembre 2001, il y a eu une vague énorme de changement dans les attitudes des renseignements US, leurs exigences et leurs capacités. De vieux plans opérationnels ont été dépoussiérés et mis à jour. D'anciens atouts ont été réactivés. Le Tibet et une faiblesse repérée dans la position de Beijing là bas ont probablement été complètement réévalués. Pour Washington et la CIA, cela peut apparaître comme une opportunité divine de créer un moyen de pression contre Beijing, sans gros risque pour les intérêts américains, une simple situation de gagnant- gagnant. Le gouvernement chinois serait, à l'autre bout, celui sujet à une condamnation mondiale pour sa répression continuelle et sa violation des droits de l'homme et ce serait les jeunes tibétains qui mourraient dans les rues de Lhassa plutôt qu'encore plus de gamins américains en uniforme. Cependant, les conséquences de toute révolte ouverte contre Beijing, sont une nouvelle fois la crainte que des arrestations, tortures et même des éxécutions se propagent à la fois dans tous les coins du Tibet et des provinces voisines où existent d'importantes populations tibétaines, comme le Gansu, Quinghai et le Sichuan. Et le Mouvement Libérer le Tibet a toujours peu de possibilité, à long terme, de réussir à obtenir une amélioration significative de la part du pouvoir politique central chinois, et absolument aucune chance de faire cesser son contrôle sur Lhasa et son pays. Une nouvelle fois, il apparaîtra que le peuple tibétain va se retrouver pris au piège entre l'oppresseur Beijing, et un Washington manipulateur. Beijing envoie des forces lourdes La crainte que les US, la Grande Bretagne, et d'autres pays occidentaux puissent essayer de montrer le Tibet comme un autre Kosovo, peut en partie expliquer la raison pour laquelle les autorités chinoises ont réagi comme si elles étaient confrontées à de véritables révoltes de masse plutôt que leur description officielle d'un court soulèvement du à des mécontents soutenant le Dalaï Lama. En effet, Beijing a pris tellement au sérieux la situation qu'une unité spéciale de coordination sécuritaire , le 110 Command Center (Centre 110 de Commande) a été installé à Lhassa, avec comme objectif principal de supprimer les troubles et restaurer complètement l'autorité du gouvernement central. Ce Centre semble être sous le contrôle direct de Zhang Qingli, le premier secrétaire du Parti du Tibet, et un loyaliste du Président Hu Jintao. Zhang est aussi l'ancien vice secrétaire du parti Xinjiang, avec une expérience considérable en matière d'opérations de contre terrorisme dans la région. Les autres qui occupent des positions importantes à Lhasa sont Zhang Xinfeng, secrétaire d'état au Ministère de la Securité Publique Centrale, et Zhen Yi, vice commandant des quartiers généraux de la Police Armée du Peuple à Beijing. Le sérieux avec lequel Beijing traite l'actuelle agitation se retrouve de plus avec le déploiement d'un grand nombre d'unités de l'armée de la Région militaire de Chengdu, dont les brigades de la 149 ème Division d'Infanterie Mécanisée, qui agissent comme force d'intervention rapide de la région. Selon un article de United Press International, des unités d'élite terrestres de l'Armée de Libération du Peuple ont été impliquées à Lhasa, et les nouveaux véhicules blindés de transports de troupes T-90, et d'autres véhicules blindés y ont été déployés. Selon l'article, la Chine a nié la participation de l'armée à la répression, disant qu'elle avait été menée par des unités de la police armée. « Cependant, de tels équipements tels que mentionnés ci-dessus, n'ont jamais été déployés par la police armée chinoise ». Le soutien aérien est fourni par le 2ème régiment de l'armée de l'air, basé à Fenghuangshan, Chengdu, et la province de Sichuan. Il opère avec un mélange d'hélicoptères et d'avions de transport STOL, d'une base située sur le front près de Lhasa. Le soutien au combat aérien pourrait être rapidement mis à disposition grâce à des bataillons de combattants de l'infanterie d'attaque basés dans la région du Chengdu. Le District Militaire de Xizang forme la garnison du Tibet, qui a deux unités d'infanterie de montagne : la 52 ème brigade basée à Linzhi, et la 53 ème brigade à Yaoxian Shannxi. Elles sont soutenues par la 8ème Division Motorisée d'Infanterie et une brigade d'artillerie à Shawan, Xinjiang. Le Tibet n'est plus si éloigné ou difficile à réapprovisionner pour l'armée chinoise. La construction de la première ligne de chemin de fer entre 2001 et 2007, a facilité significativement les problèmes de mouvement d'un nombre important de troupes et d'équipement, de Qunghai jusqu'au plateau accidenté tibétain. D'autres précautions contre une résurgence des révoltes durables des années précédentes des Tibétains a conduit à une situation d'auto suffisance considérable en matière de logistique et de réparation de véhicules, et à une augmentation du nombre de petits aéroports construits pour permettre à des unités d'intervention rapide d'avoir accès aux zones les plus reculées. On pense que le Ministère de la Sécurité chinoise et les services de renseignements ont eu une présence suffocante dans la province, et effectivement la capacité de détecter tout mouvement de protestation sérieux et de supprimer la résistance. Source : http://www.alterinfo.net/Tibet-le-Grand-Jeu--et-la-CIA_a18534.html |
| Accueil » » Le Dalai Lama agent de la CIA |
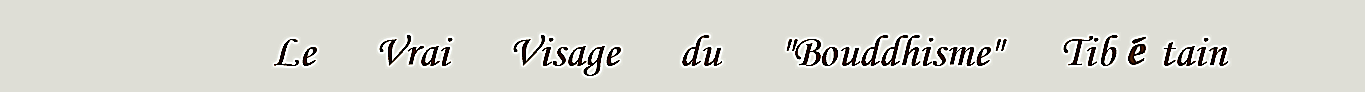
简体|正體|EN|GE|FR|SP|BG|RUS|JP|VN Le Vrai Visage du "Bouddhisme" Tibétain Accueil | Connecter | Déconnecter
- la théorie du lapin sans cornes
- La pratique du tantra Yoga
- La pratique du nectar « bdud-rtsi»
- Le Dalai Lama agent de la CIA
- Temple des Mille Bouddhas : des lamas accusés de v
- Le bouddhisme tibétain et le Dalai Lama
- Le Dalai lama et son disciple Shoko Asahara
- Tantra Kalachacra
- « Les confessions de Kalou rinpoché » sur la toile
- Un lama suspect en détention provisoire à Varennes
- Sogyal Rinpoché, pas si Zen ce Rinpoché
- Dalaï-Lama : pas si zen
- Dalaï-Lama n'est qu'un imposteur
- Des temples ... pas si accueillants
- Dalai Lama et la CIA, l'histoire d'une vieille a
- Le Dalaï Lama。 le Prix Nobel du mensonge
- Bande dessinée
- Le livre de poche
Before Buddhism was brought to Tibet, the Tibetans had their believes in "Bon". "Bon" is a kind of folk beliefs which gives offerings to ghosts and gods and receives their blessing. It belongs to local folk beliefs.
In the Chinese Tang Dynasty, the Tibetan King Songtsän Gampo brought “Buddhism” to the Tibetan people which became the state religion. The so-called “Buddhism” is Tantric Buddhism which spreads out during the final period of Indian Buddhism. The Tantric Buddhism is also named "left hand tantra" because of its tantric sexual practices. In order to suit Tibetan manners and customs, the tantric Buddhism was mixed with "Bon". Due to its beliefs of ghosts and sexual practices, it became more excessive.
The tantric Master Atiśa spread out the tantric sex teachings in private. Padmasambhava taught it in public, so that the Tibetan Buddhism stands not only apart from Buddhist teachings, but also from Buddhist form. Thus, the Tibetan Buddhism does not belong to Buddhism, and has to be renamed "Lamaism".












